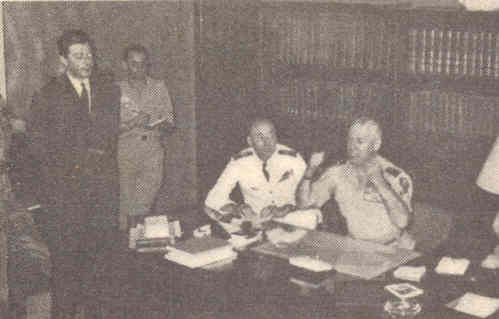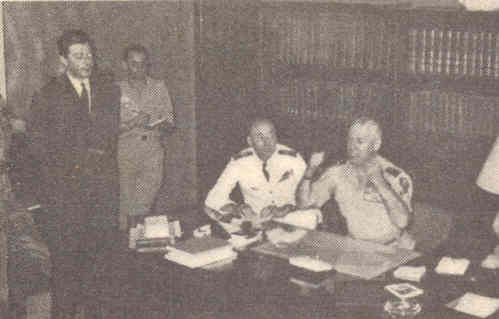
« Delbecque » dit Salan.
Vous n'êtes qu'un voyou !
Accueil
GÉNÉRAL SALAN :
Il ne pouvait être question de faire tirer la troupe.
La foule, composée en partie de femmes et d'enfants, était extrêmement dense et grossissait de minute en minute. Je m'efforçais, en la haranguant moi-même, de la calmer. Tous mes efforts restèrent vains.
A ce moment, de 15 à 20.000 personnes étaient rassemblées autour du ministère.
L'agitation allait sans cesse en s'amplifiant.
Dans son recit, le general Salan insiste sur :
« les consequences inéluctables de tout recours à la force ».
Ce souci d'eviter que ne coule le sang va le conduire, écrit-il, à accepter :
«temporairement jusqu'à decision à intervenir du gouvernement, les
responsabilités en
Algerie, après avoir revu l'accord du president Gaillard ».
M. Jules Moch, dans un témoignage publié par Midi-Libre et repris par Paris-Presse
(28 Juin 1858), semble ne pas partager l'opinion du général Salan :
JULES MOCH :
Une seule compagnie républicaine de sécurité (C.R.S.) eût suffi à rétablir l'ordre
le 13 mai au gouvernement général d'Alger, s'il ne lui avait été enjoint de
se replier dans les sous-sols du bâtiment ( Une compagnie de C.R.S. compte environ 160 hommes.).
Les scènes d'émeute étaient motivées par l'inquiétude régnant dans
cette ville après trois ans de guerre et d'assassinats, mais aussi par l'étrange
passivité du commandement.
Mais rendons la parole à Robert Martel qui écrit cette phrase décisive :
ROBERT MARTEL :
Dans la nuit, j'ai assisté à un dialogue entre J. Laquière et Delbecque, ce dernier disant à l'autre : « Ça ne s'est quand même pas passé comme on l'avait prévu. »
Ici, il convient de s'arrêter.
Dans cette affaire compliquée, la clarté ne jaillit que par étapes. Où en sommes-nous ?
L'émeute a pris possession du ministère de l'Algérie. Elle a imposé un Comité de
salut Public et a conduit le général Salan à se saisir des « responsabilités en Algérie ».
Cette décision a été sanctionnée par le président du Conseil démissionnaire,
M. Félix Gaillard, lequel s'est donc incliné devant l'émeute.
Cette émeute a été préparée - nous le savons. Mais par qui ?
Du témoignage de Robert Martel se dégage une évidence :
lui et ses amis ont « fait » cette journée. Cependant, la journée ne s'est pas
« passée comme on l'avait prévu ». Qui donc avait prévu ? Et qu'avait-on prévu ?
Entre en scène un personnage dont on va vite comprendre qu'il joue un rôle de
premier plan : Léon Delbecque. Il trouve tout naturellement place dans :
« Les 13 complots du 13 Mail » (Fayard) :
S. ET M. BROMBERGER :
Léon Delbecque est un commando à lui tout seul. Taillé en athlète, beau garçon,
le sourcil froid, le regard levé au loin, mais le clin d'il canaille, il impose
malgré sa jeunesse.
Il est plus qu'entreprenant : il est dévoré d'activité.
Il a un sens extraordinaire de l'organisation politique.
Il est un self-made man; issu d'une famille ouvrière du Nord, il a passé ses
baccalauréats et il a participé, très jeune à la Résistance...
En 1946, il milite avec René Capitan dans l'Union Gaulliste de Lille, puis
dans le RPF de 1947 à 1951. Il se présente deux fois aux éléctions.
Trop jeune pour être inscrit en tête de liste, il est deux fois blackboulé...
Le RPF dissous, il devient secrétaire général de la Fédération du Nord des Républicains Sociaux, qui en sont issus.
Que fait à Alger, le 13 mai 1958, Léon Delbecque?
Il est tout simplement l'envoyé du ministre Chaban-Delmas « pour préparer en Algérie les conditions qui imposeront Charles de Gaulle malgré
l'opposition parlementaire» (Bromberger).
Déjà, bien des noms sont apparus, au long des pièces de ce dossier.
Pour la première fois s'imprime celui de Charles de Gaulle. Il est hors de conteste qu'il va dominer - de très haut - cette étrange révolution venue d'outre-mer, et dont il n'existe pas d'exemple dans notre histoire nationale.
Depuis l'échec du RPF, le général de Gaulle s'est retiré à Colombey-les-Deux-
Eglises.
Là, moderne Cincinnatus, il rêve au passé et considère le présent.
Il rédige ses Mémoires. Les deux premiers tomes ont révélé au monde que Charles de
Gaulle était un grand écrivain français.
Songe-t-il au pouvoir ? Non. Du moins, il ne fera rien pour s'en emparer.
Un mois et demi avant le 13 mai, il accordait une audience au Comité d'action
nationale des Associations d'anciens combattants.
Le procès-verbal de cette entrevue est révélateur.
J.-R. TOURNOUX :
Le général n'a aucune intention précise. Il se refuse catégoriquement à envisager
son retour dans le cadre du régime actuel, quelles que soient les modalités
de ce retour. Il sait d'ailleurs que jamais le Parlement ne le rappellera avant la
catastrophe finale...
Le général ne veut avoir à tenir compte ni de la « droite » qui ignore ce qu'est
la nécessité de la générosité, ni de la « gauche » qui se refuse à la nécessité
de la puissance...
Le général sait que de larges fractions de l'opinion publique lui reprochent de
n'avoir pas fait depuis quatre ans de déclarations sur les grands problèmes
qui affectent la Nation; il se refuse à les faire parce qu'il considère que ses
paroles, et les intentions qu'elles exprimeraient, seraient immédiatement déformées
et utilisées à contre-sens par les différentes factions qui se disputent le
pouvoir.
Par exemple, s'il déclarait à propos de l'Algérie et de l'Afrique la nécessité de la générosité et du libéralisme, une faction s'en emparerait pour pousser à la
capitulation. S'il évoquait la nécessité de la présence française et de son maintien en Afrique, une autre faction en profiterait pour refuser toute solution politique des problèmes africains.
Il en serait de même en ce qui concerne l'Europe ou l'Alliance atlantique...
Ce document est sans doute l'un des plus importants de l'histoire du 13 mai.
Cependant, si le général ne songe point directement au pouvoir, d'autres y pensent pour lui. L'analyse que donne Jacques Fauvet apparait très exacte.
JACQUES FAUVET :
Le 13 mai, deux pouvoirs s'instaurent : le pouvoir légal à Paris et le pouvoir
militaire à Alger.
Un troisième, le pouvoir moral, celui du général de Gaulle, est encore à Colombey.
De longue date, une poignée de gaullistes n'a vécu que dans l'espérance de
son retour au pouvoir; ils étaient moins nombreux encore à n'avoir aucune part
« aux jeux et aux délices » du système et au premier rang de ceux-là se trouvait
M. Michel Debré, le seul qui, à chaque crise, se bornait à répéter avec l'obstination
rituelle d'un fidèle, ou même d'un dévot :
« Il n'y a pas d'autre homme que le général de Gaulle. »
Pour que le général revienne au pouvoir dans la légalité, il fallait deux
conditions ; une grande peur qui forcerait la décision du Parlement et, compte tenu
de sa composition, un ralliement difficile, celui de la S.F.I.O. M. Chaban-Delmas l'avait bien compris et non moins espéré depuis 1956 qui s'était mis en tête de rapprocher un jour le général
de Gaulle et M. Guy Mollet.
C'est le même Chaban-Delmas qui a envoyé Léon Delbecque en Algérie.
Celui-ci y a découvert une notion d'importance, la popularité de Jacques Soustelle.
Delbecque en tire très vite une conclusion : seul Soustelle peut conquérir l'Algérie au
gaullisme. Delbecque sera donc « l'homme de Soustelle ».
Ainsi parviendra-t-il à « recréer de Gaulle ».
Cependant qu'il prépare - pour de Gaulle, mais sans de Gaulle - le jour « J » à Alger,
Il a senti le besoin de rencontrer le général. Il a voulu le persuader.
Voici la conclusion de cet étonnant dialogue :
- Si, à la suite de circonstances très graves, l'armée, le peuple vous appelaient,
répondriez-vous oui ?
De Gaulle se tait l'espace d'un instant, lance sa tête en arrière et, altier, marque ses distances :
- Delbecque, j'ai toujours eu l'habitude de prendre mes responsabilités.
Il n'en a pas fallu plus pour que le « Chtimi » monte l'opération d' Alger.
Ce mardi 13 mai, à 9 heures du soir, Delbecque et ses deux patrons :
Soustelle et de Gaulle, ont perdu.
Le gagnant, c'est Pierre Lagaillarde et peut-être, seule figure populaire de
l'opposition non gaulliste au système : Pierre Poujade.
L'émeute plus ou moins improvisée l'a emporté sur les plans longuement concertés.
Tout est-il perdu ? Non, car Delbecque ne désespère pas. L'insurrection non gaulliste a triomphé; le Comité de salut public n'est pas gaulliste; le général Salan, seul maitre de l'Algérie, n'a jamais porté « le perchoir » ( la croix de Lorraine );
Il ne fera pas pencher la balance pour les gaullistes.
C'est alors que Léon Delbecque parvient au G.G.
Il se présente :
S. ET M. BROMBERGER :
- Léon Delbecque ! Je suis l'envoyé
de Jacques Soustelle !
Le nom de Soustelle fait sensation. C'est le nom-clef pour les Algérois. Ils
l'ont hurlé tout l'après-midi.
On fait place à Delbecque. On l'inscrit sur la liste du Comité qui s'enrichit en
même temps de toute une série de membres du Comité de vigilance.
Delbecque s'impose avec beaucoup d'autorité. Il ne s'attarde d'ailleurs pas là et va presque
ausitôt prendre contact avec les bureaux voisins.
L'acccueil d'ailleurs y est rude...
Le général Salan accueille le conspirateur avec le même qualificatif que, tout à
l'heure, Ducournau !
- Vous n'êtes qu'un voyou !
Cependant, la conversation péniblement engagée entre le général et le leader
gaulliste se poursuit.
Très adroitement Delbecque parle du général de Gaulle dont l'arrivée au pouvoir résoudra tous les problèmes...
Les deux hommes se séparent d'accord :
le Comité de salut public se soumettra au commandement militaire.